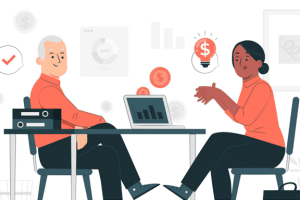Les rémunérations, un casse-tête pour les profils très expérimentés
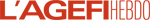
Table-ronde des chasseurs de tête (version intégrale)
Cinq chasseurs de têtes abordent, lors de ce rendez-vous annuel, les sujets de l’emploi, du recrutement et des rémunérations dans la finance.
Propos recueillis par Soraya Haquani
Participants :
Valérie Barthes, CTPartners
Thierry Carlier-Lacour, Nicholas Angell
Denis Marcadet, Vendôme Associés
Eric Singer, Singer & Hamilton
Barbara Valaperti, Korn/Ferry International
L’Agefi Hebdo – Aujourd’hui, l’emploi dans la finance est toujours en crise. Quels métiers continuent à recruter ?
Barbara Valaperti – En banque de financement et d’investissement (BFI), les recrutements se font à la marge. Ceux qui emploient sont l’exception. Cette exception n’a pas concerné que la France, mais aussi d’autres zones géographiques. On observe surtout des jeux de chaises musicales. Lorsqu’un poste important est vacant, il faut le pourvoir et remplacer celui qui est nommé. Mais il s’agit de seulement quelques cas. Les BFI françaises ont beaucoup fait jouer la mobilité interne, par exemple en plaçant des spécialistes du corporate finance sur du coverage (couverture clients). Au bout du compte, les boutiques ont bénéficié de ce contexte. Elles en ont profité pour avoir accès à des profils qu’elles n’auraient pas pu envisager de recruter il y a deux ans. Ces embauches de boutiques se font beaucoup en direct, ce type d’établissement fait rarement appel aux grands cabinets de chasse internationaux.
Denis Marcadet – La finance bancaire fait moins rêver, ce n’est pas le secteur le plus actif en matière d’embauches. Des services financiers à la gestion d’actifs ou à la BFI, tous les secteurs sont affectés. La BFI est particulièrement touchée, plans sociaux et restructurations prédominent, il n’est pas question d’embauches, et pour les besoins d’effectifs, la priorité absolue est la mobilité interne. La prudence est de mise dans la gestion des équipes. Fermeture ou réduction de lignes métiers (notamment à l’international) ont conduit à des réaffectations, souvent du front-office vers des fonctions supports, notamment les métiers de risque/contrôle ou de coverage. Ces derniers transferts ont aujourd’hui été réalisés, en priorité via des profils expérimentés aptes à générer du PNL (profit & loss, indicateur de mesure de la performance des activités, NDLR). Il peut actuellement y avoir quelques besoins, notamment en gestion de bilan, risque de crédit ou encore de spécialistes sectoriels (en analyse financière notamment), mais il n’y a pas de métier en pointe qui suscite une vague d’embauches. Néanmoins, le marché montre des signes de frémissements et reprend vie progressivement, les institutions financières sont de nouveau en recherche d’informations et, incontestablement, il y a de nouveau (toujours) une place pour les profils talentueux… Ce sont les structures indépendantes qui recrutent actuellement. Par ailleurs, bien qu’il y ait un certain nombre de professionnels disponibles et que les réseaux fonctionnent bien, le recours au chasseur reste de mise, source pour l’entreprise d’une information pertinente, plénière, différenciante et d’une qualité de sélection. Il s’effectue dans un cadre élargi, en amont et en aval du recrutement. Benchmark, étude de rémunération et analyse comparative des organisations font partie de notre quotidien au même titre que la validation de profils, une fonction de conseil et d’accompagnement particulièrement prisée dans des sociétés à faibles effectifs (boutiques, fonds d’investissement, sociétés de gestion…).
Valérie Barthes – Ces acteurs vont en effet avoir recours à nous pour valider ce que pense le marché, ce que pensent leurs clients. S’ils doivent recruter plusieurs personnes, ils voudront évaluer comment telle personne «fonctionne» avec telle autre. Cela a plus d’impact dans une boutique qui est constituée d’une petite équipe que dans une grande BFI où les personnalités sont plus diluées. De manière générale, les fonctions qui sont au contact des clients restent le nerf de la guerre en BFI comme en gestion d’actifs. Chacun cherche le meilleur et cela crée un mouvement naturel. La BFI est clairement plus sinistrée. Du côté de l’asset management, je note toutefois que dans la recherche en compétences de gestion, certains veulent compléter et enrichir leur offre, et cette volonté peut s’illustrer partout. Il y a même des acteurs français de petite ou moyenne taille, auparavant très domestiques, qui iront compléter des expertises, comme l’ISR (investissement socialement responsable) ou les émergents, en créant un bureau là où ils savent qu’ils trouveront la bonne équipe de gérants. Ils n’hésitent plus à le faire. Leur recherche de talents s’est généralisée, elle est mondiale.
Thierry Carlier-Lacour – Actuellement, la place financière française est extrêmement atone en matière de recrutement en BFI. Toutefois, on voit des demandes assez étonnantes en début d’année, principalement en provenance d’institutions américaines qui ont fait «leur marché» au sein des banques françaises en ce qui concerne en particulier les financements en dollars. Elles ont recruté des petites équipes en récupérant des experts sur les financements shipping, aéronautique, pétrole, commodities, etc. Mais encore une fois, cela reste marginal et le marché du recrutement français en BFI reste sinistré. Concernant la gestion d’actifs, on constate très peu d’embauches externes dans les grandes maisons, à l’exception de recrutements strictement opportunistes. A contrario, le marché est assez dynamique pour certaines sociétés de taille moyenne, voire entrepreneuriales. Dans ce cas et à travers notre activité de chasseur de têtes, nous agissons également en tant que conseil RH.
L’Agefi Hebdo – La gestion d’actifs et la banque privée sont donc des segments plus porteurs, qui peuvent éventuellement absorber d’anciens banquiers de BFI ?
Denis Marcadet –Ils ont été porteurs, notamment du fait de la mise à niveau des fonctions de risque/contrôle, mais aujourd’hui ces secteurs rentrent dans le rang. Il n’en demeure pas moins qu’en gestion d’actifs, un bon commercial sera toujours courtisé ; il y aura toujours une société de gestion prête à le recruter. La démarche est avant tout opportuniste, il ne s’agit pas d’une politique délibérée et de fond. Ce constat est applicable à la banque privée, où l’importance des actifs sous gestion et la pérennité de la clientèle en portefeuille sont la porte ouverte à toute sollicitation. Toutefois, rares sont les sociétés où les équipes ne sont pas bien en place et parfaitement équipées. Pour autant, il suffit d’un simple mouvement, d’une restructuration, pour générer une mobilité en chaîne et créer un effet boule de neige. Quant à l’intégration d’anciens banquiers, elle s’inscrit dans cette même démarche opportuniste, étant entendu que le lien entre M&A (fusions-acquisitions) et asset management ou banque privée a toujours existé pour les professionnels en relation directe avec les clients. A noter que certains segments sont plus facilement «fongibles» dans la banque privée, comme l’immobilier.
Eric Singer – Je ne crois pas qu’on devienne un grand gérant du jour au lendemain. Petit à petit, on acquiert ces compétences, on a le sens du marché. Un gérant d’actifs n’est pas un trader. Il n’a pas les mêmes contraintes. Les siennes sont comptables, fiscales, sociales pour la gestion assurancielle. Je ne pense pas que le mythe du trader qui rejoint un hedge fund va s’industrialiser. Aujourd’hui, il y a tellement peu de gérants de qualité qu’ils sont recherchés très activement pour leur track record et leur capacité à générer des revenus. Les revenus des sociétés de gestion baissent, il faut donc réaliser les meilleures performances. Mais ce n’est pas avec des traders, même excellents, que l’on va collecter des actifs supplémentaires et afficher des performances accrues car leur track record n’est ni public, ni audité. Concernant les passerelles avec la banque privée, certains acteurs mènent des actions originales : avec son programme nommé «Embark», Barclays propose aux salariés qui en ont les qualités de rejoindre sa division de wealth management. Il s’agit d’un programme de plusieurs semaines durant lesquelles sont abordées la fiscalité, la relation avec le banquier privé, le patrimoine, etc. Il s’agit là d’un système formalisé, qui n’existe pas dans d’autres banques européennes.
Thierry Carlier-Lacour – Il y a une tendance de fond permanente à rechercher des banquiers privés avec des actifs, et ce en raison notamment des nouvelles contraintes réglementaires. Dans ce contexte, toutes les sociétés essaient de convaincre des banquiers privés maîtrisant leur portefeuille de clients à les rejoindre. Les banquiers de BFI peuvent se faire une place dans ce marché spécifique si, et seulement si, ils ont la capacité «de lever» très rapidement de nouveaux actifs auprès de leurs contacts.
Barbara Valaperti – Si un banquier privé qui gère des sommes conséquentes a envie de bouger, il trouvera preneur. Il y a eu des transfuges de professionnels d’autres métiers vers la banque privée, mais cela n’a pas été une vague de fond. Cela n’a d’ailleurs pas toujours été un succès. C’est en théorie quelque chose de réalisable, mais en réalité cela se fait à la marge. Là aussi, le métier de la banque privée est un métier de très long terme. On ne s’improvise pas banquier privé. Ce n’est pas parce que l’on a une relation avec un dirigeant que l’on a conseillé sur la vente de son entreprise que l’on peut se décréter le lendemain son conseiller privilégié pour gérer son patrimoine et sa succession. Ce sont des choses qui peuvent se faire, mais elles prennent du temps.
L’Agefi Hebdo – Le sujet des rémunérations est-il complexe à gérer compte tenu des récentes réglementations ?
Valérie Barthes – L’environnement change, la réglementation change, c’est vrai. Mais notre métier ne s’est pas pour autant transformé dans la mesure où il y a une offre, une demande et un prix de marché. On continue à trouver un seuil qui convient à tout le monde. La structuration du package est peut-être plus compliquée entre les différents éléments. Ce n’est pas tant un sujet de rémunération pour les candidats qu’un sujet de projet. Les gens ne bougent plus «pour bouger» en se disant que l’herbe est plus verte ailleurs et que de toute manière, si cela ne fonctionne pas, ils retrouveront facilement un autre poste dans six mois. Ils mettent beaucoup plus de temps à se décider pour le «bon» projet. On revient aux fondamentaux : quel est le projet, quelle est la stratégie de l’entreprise, quelle est sa pérennité, quelle va être mon évolution dans l’entreprise à trois ans, à cinq ans ou à dix ans ? Ce sont des questions assez saines finalement.
Denis Marcadet – Les rémunérations sont un sujet majeur, souvent casse-tête pour des profils très expérimentés de spécialistes, managers ou encore commerciaux talentueux, notamment pour la partie variable de la rémunération et la gestion des «differed» (primes différées dans le temps, NDLR). Cela est traité différemment selon le vécu et la situation du candidat. Ne pas omettre que nombre de candidats le sont devenus par la force des choses après des fusions, restructurations ou absorptions. Ils n’ont, de fait, pas les mêmes attentes ni le même raisonnement que celui que l’on va chercher. Majoritairement, en matière de rémunération aujourd’hui, l’humilité prime. Malgré le fait que certains managers, au moment de distribuer les bonus en début d’année, aient évoqué «votre bonus, c’est votre job”, on peut toujours parler de bonus, ce n’est pas un sujet tabou. Il reste une composante clé pour certaines fonctions et les excellents producteurs l’abordent d’entrée. Globalement, les mobilités sont compliquées par la prise de risque inhérente au contexte, et pour un nouvel entrant ou un acteur désireux de renforcer une équipe, la rémunération (notamment fixe) reste une composante essentielle. En revanche, côté entreprise, les processus d’allocation de bonus sont très stricts. A partir de certains montants la décision remonte au plus haut niveau de la hiérarchie de l’entreprise, dont le président. Un processus qui prend du temps, beaucoup de temps… Dans ce contexte de marché, pour ceux qui sont réellement désireux de changer, tant qu’à prendre un risque, un projet entrepreneurial avec un vrai «reward» (actions, BSA ou autres) peut constituer une alternative pertinente.
Eric Singer – Aujourd’hui, en capital market, on reprend un bonus et on le garantit. Par exemple, en 2011 chez RBS, le bonus se composait de 70 % en cash et de 30 % en titres, pour des montants relativement importants. Une vraie difficulté se pose lorsque le nouvel employeur garantit un bonus pour faire en sorte que le cash que la personne touchera dans son entreprise soit supérieur ou au moins égal au cash qu’il aurait pu percevoir dans son entreprise précédente. Les modèles de rémunération ne sont pas du tout harmonisés entre les banques. Il y a une hypocrisie anglo-saxonne qui est épouvantable. En outre, il y a le sujet de la fiscalité. Lorsque l’on fait venir des gens en France, le statut d’impatrié est extrêmement compliqué à mettre en place. Pourtant, il est indispensable.
Barbara Valaperti – Dans le capital-investissement, la valeur du carried interest (intéressement dont bénéficient les gérants sur la plus-value réalisée par leur fonds, en général 20 %, NDLR) a beaucoup baissé et on peut difficilement en donner une évaluation réelle. Demandez à un candidat quelle est la valeur de son carried, s’il est un peu honnête intellectuellement, il n’aura pas de réponse claire. On négocie aujourd’hui tout autant sur le salaire et le bonus que sur le carried. Cela étant, il existe des fonds très performants dont le carried a une valeur réelle et qui, du coup, offrent une part en cash moins importante. Lorsque l’on recrute pour un fonds, les candidats sont très attentifs à leur salaire et à leur bonus.
Thierry Carlier-Lacour – On sent une forte stagnation, voire une tension à la baisse sur les rémunérations en France. En effet, il n’est pas rare qu’un candidat se voit proposer une rémunération inférieure à ce qu’il perçoit, y compris pour des fonctions très dimensionnées ! Les établissements mettent exclusivement en avant leur projet et leur solidité. A l’inverse, sur d’autres territoires limitrophes tels que le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Suisse principalement, il y a moins de difficultés «à payer» les bons profils dès lors qu’ils apportent une valeur ajoutée immédiatement.
L’Agefi Hebdo – Les enjeux de diversité et de mixité des entreprises impactent-ils vos missions ?
Barbara Valaperti – Sur le sujet des femmes, la tendance est claire. Systématiquement, les clients, s’ils ne le demandent pas de prime abord, regardent la liste des candidats proposés pour voir s’il y a des femmes. Auparavant, ils ne le faisaient pas. Il nous arrive de mettre dans notre proposition de service un paragraphe dans lequel notre cabinet s’engage à respecter la diversité : nos clients du secteur bancaire ont mis en place des politiques de diversité et tous les patrons des grandes divisions ont désormais des objectifs de diversité au sein de leurs équipes. Ce qui veut dire qu’ils sont fortement mis sous pression pour faire évoluer des jeunes femmes vers des postes de plus en plus seniors. Cela se voit. Des équipes qui étaient purement masculines commencent à se féminiser, ce qui rend notre métier plus facile car plus les banques font monter des femmes vers des postes à responsabilités, plus ces femmes vont figurer dans nos missions de chasses. Les femmes étaient quasiment inexistantes dans les comités exécutifs. Aujourd’hui, elles y sont présentes.
Denis Marcadet – Raisonnablement, on se doit par exemple d’intégrer a minima au moins une femme dans la «short list» de candidats présentés ; ce qui, sur certaines fonctions de front-office souvent très masculines, peut parfois être difficile. Mais globalement, c’est plutôt un non-sujet car comparativement à d’autres secteurs, historiquement, les banques ont toujours joué le jeu de la diversité. Par ailleurs, avec la croissance des marchés émergents, la diversité et la maîtrise d’une langue ou d’une culture sont particulièrement recherchées.
Thierry Carlier-Lacour – La plupart des établissements pour lesquels nous intervenons sont particulièrement sensibles à ce sujet et nous imposent parfois même un «quota» lors de la présentation de nos «short lists». Cette approche ne fait que favoriser l’ouverture des profils recherchés. On peut donc considérer que l’impact est plutôt positif, aussi bien pour les candidats que pour les entreprises.
L’Agefi Hebdo – Les recruteurs ont-ils de nouvelles demandes concernant les candidats, par exemple en matière d'”assessment” (évaluation) ou de prises de références ?
Barbara Valaperti – Chez Korn/Ferry, nous avons un outil d’évaluation qui est assez puissant. Toutes les personnes qui l’ont utilisé ont pu constater sa justesse. Il s’agit d’un outil percutant et simple qui s’effectue via internet en quarante-cinq minutes. C’est un atout complémentaire que nous utilisons de manière systématique auprès de nos candidats et qui fait aussi partie intégrante de nos activités LTC (Leadership & Talent Consulting).
Valérie Barthes – Cela s’inscrit dans le cadre de la durée d’allongement des processus de recrutement et du nombre de personnes rencontrées. Notre métier est d’abord de fournir un jugement sur une personne, et aussi de réduire au maximum le risque de nos clients. Plus on aligne de méthodes en parallèle pour réduire ce risque, plus le client est rassuré et plus il arrivera à prendre sa décision facilement. C’est logique dans un environnement aussi anxiogène que celui de la finance depuis 2008. Les tests psychométriques peuvent faire partie de ces méthodes, comme des entretiens de compétences très poussés. Tout cela va dans le même sens. On fait appel à nous pour réduire au maximum le risque d’erreur dans le choix du candidat.
Denis Marcadet – Côté entreprise, le processus de décision est souvent de plus en plus long. Entre le moment où vous présentez les candidats et le moment où les entretiens se déroulent, il se passe souvent plusieurs semaines. Par ailleurs, si le nombre d’intervenants a eu tendance à diminuer (en moyenne cinq personnes au lieu de huit, voire plus par le passé), la prise de décision au terme des rencontres fait elle aussi l’objet d’une longue maturation, il est donc de plus en plus fréquent que plusieurs mois s’intercalent entre le premier rendez-vous et la remise d’un contrat au candidat retenu. Chaque recrutement est mûrement pesé et réfléchi. La période d’essai ne joue plus son rôle de round d’observation réciproque, mais uniquement celui d’une variable d’ajustement à l’activité économique. Les recruteurs ne veulent donc pas se tromper. Le rôle de conseil et la confiance historique générée par les cabinets qui ont su nouer des liens étroits suffisent en règle générale. C’est souvent au cas par cas et lié à la fonction, et des investigations complémentaires (assesment, tests) peuvent être effectués. En tout état de cause, il est procédé de manière systématique à une prise de références.
Eric Singer – En ce qui nous concerne, nous préférons toujours la prise de références. Elle permet d’obtenir le plus d’informations vécues. Dans ce cadre, même les non-dits sont importants. Avec un nombre suffisant de références et une bonne connaissance des acteurs du marché, on arrive à se faire une opinion assez exacte du candidat. Parallèlement, nous avons accès à des informations objectives relatives aux performances des fonds, deal lists de fusions-acquisitions, taux de rentabilité interne dans le non-coté… que nous ne manquons pas d’analyser scrupuleusement.
L’Agefi Hebdo – La prise de références doit-elle obéir à des restrictions légales ?
Barbara Valaperti – Oui certainement, et en France la prise de références est très réglementée ! Nous avons un centre de compétences à Londres dédié à la prise de références où un partner est en charge de l’activité appelée «référence checking». Outre-Manche, la prise de références est beaucoup plus libre. En France et en Italie, c’est le candidat qui a été prévenu de la prise de références qui fournira les noms des personnes à contacter. Si un candidat s’est séparé d’un précédent employeur dans le cadre d’une négociation, il sera impossible d’obtenir les raisons et les détails de cette séparation. Mais notre partner londonien jouit de plus de liberté d’action et ses rapports de références sont extrêmement fouillés et pertinents ; le résultat est absolument probant. Elle intervient lorsque le candidat est «short-listé». J’ajoute que ce partner n’étant pas impliqué dans les missions de recrutement, elle agit en totale objectivité car elle n’a aucun intérêt à ce que le candidat soit placé ou non. L’approche est donc très différente.
Eric Singer – Absolument, la prise de références est encadrée. Il me semble nécessaire d’avoir l’accord écrit de l’intéressé. Et que ce dernier informe les personnes qui seront interrogées.
Denis Marcadet – La prise de références a toujours fait partie de la procédure de recrutement, mais elle est abordée différemment selon la taille des entreprises, les groupes anglo-saxons par exemple souhaitant l’externaliser entre les mains d’un seul prestataire qui n’est pas celui qui gère la recherche. Avec plus ou moins de bonheur parfois et pas toujours effectuée comme il se doit en fin de processus. Il faut l’encadrer et la légitimer. Par ailleurs, il existe un cadre réglementaire à ces investigations que ne maîtrisent pas forcément les non-professionnels. Aujourd’hui, plus personne ne contacte l’employeur actuel d’un candidat qui ne l’aurait pas proposé spontanément. Ce genre de pratiques qui a rendu, à juste titre, les candidats extrêmement frileux ne devrait plus se voir… que dans les films !
Valérie Barthes – Même dans une optique totalement constructive où il n’y a rien à «déminer», où il n’y a pas de sujet, il est fondamental pour notre client de mieux comprendre les ressorts d’une personne pour parvenir à garantir son succès dans son nouveau poste et au sein de l’entreprise. On sait tous que les erreurs de recrutement sont rarement liées à des compétences techniques, mais davantage à des problèmes d’adéquation culturelle. La prise de références sert non seulement à vérifier qu’il n’y a pas de «cadavre dans le placard», ce qui est très important, mais elle sert aussi à assurer la réussite de la personne, sa meilleure intégration dans une nouvelle culture, de nouveaux modes de fonctionnement, etc. C’est un beau défi.